
ChronoMath, une chronologie des MATHÉMATIQUES
à l'usage des professeurs de mathématiques, des étudiants et des élèves des lycées & collèges

 Waring étudia au Magdalen
College de Cambridge
et obtint (1760) la chaire de professeur
lucasien pour l'enseignement des mathématiques, chaire encore très prisée de nos jours
qui fut créée
(entre autres fondations caritatives) par la volonté testamentaire du Révérend
Henry Lucas (1610-1663), membre du Parlement de l'université de Cambridge.
L'actuel titulaire (2007) est le célèbre astrophysicien Stephen William
Hawking.
Waring étudia au Magdalen
College de Cambridge
et obtint (1760) la chaire de professeur
lucasien pour l'enseignement des mathématiques, chaire encore très prisée de nos jours
qui fut créée
(entre autres fondations caritatives) par la volonté testamentaire du Révérend
Henry Lucas (1610-1663), membre du Parlement de l'université de Cambridge.
L'actuel titulaire (2007) est le célèbre astrophysicien Stephen William
Hawking.
Les travaux de Waring portèrent sur les équations algébriques dans l'étude des fonctions symétriques des solutions, l'arithmétique et les séries numériques. Waring fut élu à la Royal Society en 1763. On lui doit en particulier, en latin, langue véhiculaire des sciences toujours en usage au 18è siècle :
• Meditationes analyticæ (1759);
• Miscellanea analytica de æquationibus algebraicis et curvarum proprietatibus (1762), soit Analyses diverses sur les équations algébriques et sur les propriétés des courbes;
• Meditationes algebraicæ (1ère édition en 1770) où il développe d'importants sujets d'arithmétique.
|
Problème (ou conjecture) de Waring : |
C'est dans ses Meditationes algebraicæ (1770, réf.1c) que Waring énonce sa fameuse conjecture arithmétique selon laquelle :
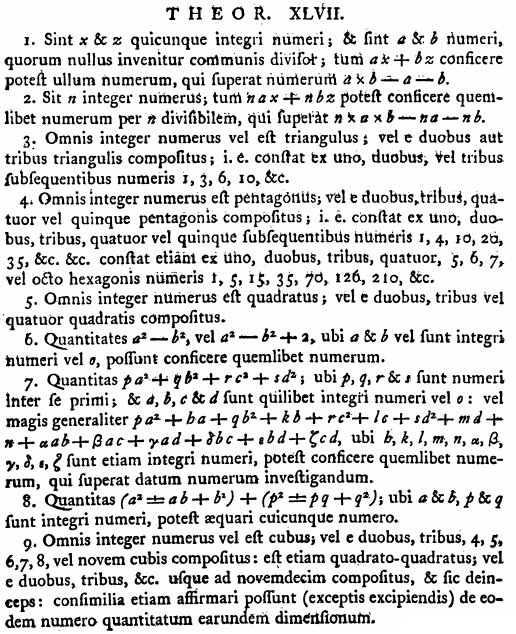
Si vous n'êtes pas latiniste, en voici, sensiblement, la traduction :
5. Tout entier est un carré ou un composé de deux, trois ou quatre carrés.
9. Tout entier est un cube ou bien somme de deux, trois, 4, 5, 6, 7, 8, ou neuf cubes; il est aussi le carré d'un carré ou bien somme de deux, trois, etc., jusqu'au plus dix-neuf, et ainsi de suite (sauf exception).
i Par carré d'un carré, ou encore bicarré, on entend puissance 4ème : le carré du carré (x2)2 = x4. Ce terme n'est pas désuet : au lycée, on parle encore d'équation bicarrée pour exprimer une équation du quatrième degré du type x4 + bx2 + c = 0 que l'on résout en posant x2 = y ≥ 0 : l'équation prend la forme y2 + by + c = 0. On se ramène ainsi au second degré sous la condition y ≥ 0. On a alors x = ± √y.
La conjecture peut s'écrire :
Pour tout entier n et tout entier k ≥ 2, il existe p entiers n1 , n2 , ... , np tels que n = n1k + n2k + ... + npk
239 est le plus grand entier se
décomposant en neuf cubes (au-delà huit, voire sept, suffisent)
239 = 13 + 13 + 13 + 33 + 33
+ 33 + 33 + 43 + 43
Ce type de problème (équation diophantienne) dont se délectait le prussien Christian Goldbach une quarantaine d'années auparavant, s'inscrit dans ce que l'on appelle aujourd'hui la théorie des partitions à laquelle s'intéressèrent de nombreux mathématiciens depuis l'Antiquité avec, tout particulièrement, Nicomaque de Gérase.
Lagrange démontra la conjecture relative aux quatre carrés (» réf.2) :
Tout entier naturel est la somme d'au plus quatre carrés
Ce résultat avait été avancé avant Waring par Bachet de Méziriac. En 1909, le mathématicien allemand Arthur J. Wieferich (1884-1954) prouva la conjecture relative aux neuf cubes. La même année, Hilbert apporte une démonstration complète de l'existence d'une telle décomposition mais il n'en précise pas les conditions. Littlewood, Ramanujan, Hardy et Vinogradov apporteront des solutions plus précises mais encore partielles à ce difficile sujet (» réf.5).
Programmation de la conjecture des 4 carrés : » Les trois types de théorie des nombres : »
On peut citer semblablement ces deux conjectures prouvées par Gauss :
Somme de deux carrés :
Tout nombre premier de la forme 4n + 1 se décompose de façon unique en somme de deux carrés
Somme de trois carrés :
Tout nombre entier qui n'est pas de la forme 4n(8m + 7) est somme de trois carrés
Somme de deux ou trois cubes :
Un entier naturel n non nul peut-il s'écrire sous la
forme x3 + y3 ou bien x3 + y3 + z3
x, y, z étant eux-mêmes
entiers non nuls dans N ou Z ?
Ce type de décomposition, à laquelle s'intéressa en particulier Fermat, Euler et, au 20è siècle, Davenport, Landau, Mordell (On sums of three cubes, 1942) à la recherche de solutions rationnelles, reste aujourd'hui encore un problème ouvert. Réexposé comme un défi grâce à l'outil informatique, le problème s'avère d'une grande complexité. Des stratégies appliquées à certains types d'entiers ont été mis au point mais aucun algorithme général n'a été exhibé.
i En 1825, S. Ryley, instituteur à Leeds (Angleterre), publie un article dans le Ladies' Diary, un almanach anglais très en vogue au 19è siècle (» réf.9&10), où il prouve que tout nombre rationnel est somme de trois cubes rationnels (éventuellement négatifs).
Quelques exemples :
1 = 13 + 13 + (-1)3 ; 2 = 73 + (-6)3 + (-5)3 ; 3 = 13 + 13 + 13 = 43 + 43 + (-5)3 ;
6 = (-1)3 + (-1)3 + 23 ; 7 = 1043 + 323 + (-105)3 ; 9 = 2173 + (-216)3 + (-52)3 ; 10 = 43 + (-3)3 + (-3)3 ; ...
42 = (- 80 538 738 812 075 974)3 + (80 435 758 145 817 515)3 + (12 602 123 297 335 631)3 (Andrew Booker, 2019).
En savoir plus sur ces décompositions : »
➔ Pour en savoir plus :